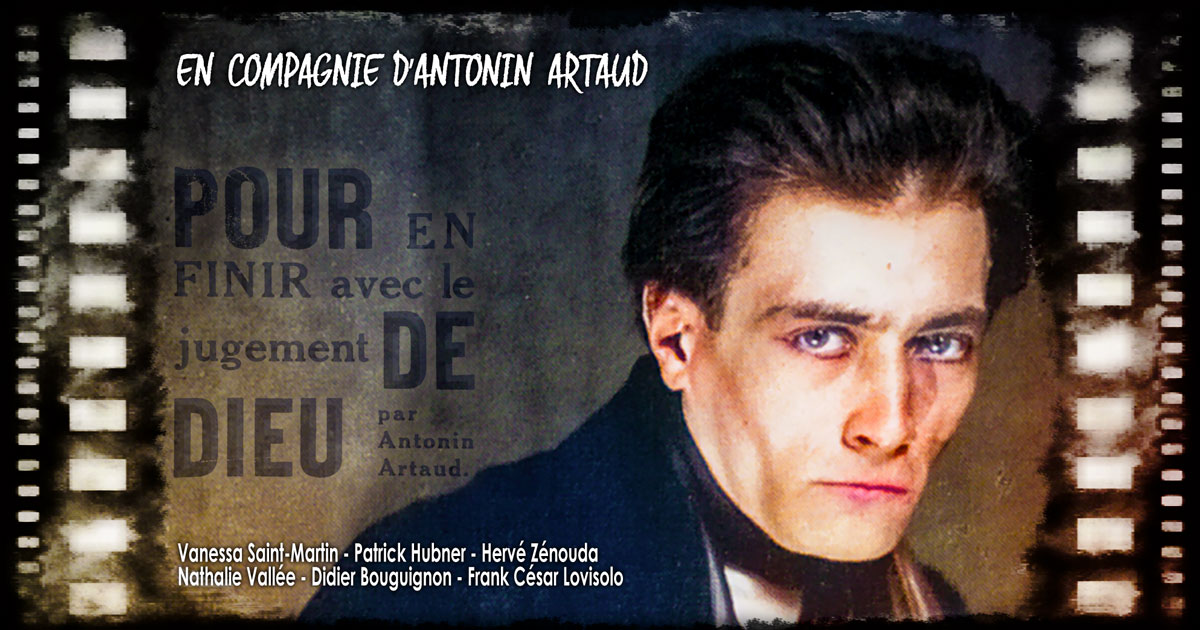Le port gréco-romain d’Olbia à Hyères : une implantation stratégique et patrimoniale

Située sur la commune actuelle d’Hyères, dans le Var, la cité antique d’Olbia de Provence constitue un site archéologique majeur pour la compréhension de l’implantation gréco-romaine en Méditerranée occidentale.
Fondée au IVᵉ siècle av. J.-C. par les Grecs de Massalia (l’actuelle Marseille), elle a connu un développement progressif avant de passer sous contrôle romain. Conçue à la fois comme un poste militaire, une colonie agricole et un point d’appui commercial, Olbia s’inscrivait dans un réseau d’échanges maritimes et côtiers qui reliait la Gaule méridionale à l’ensemble du bassin méditerranéen.
1. La fondation grecque : une colonie massaliète
La création d’Olbia s’inscrit dans la politique coloniale de Massalia, qui, dès le VIᵉ siècle av. J.-C., fonde de nombreux établissements côtiers (comme Tauroeis ou Antipolis) afin de sécuriser ses routes commerciales et de contrer l’expansion des peuples étrusques et celto-ligures. Le choix du site d’Hyères, à proximité immédiate des îles d’Hyères (Porquerolles, Port-Cros, etc.), répond à une logique stratégique : contrôle de la navigation, surveillance du littoral et protection des routes commerciales reliant la Méditerranée orientale à la Gaule.
L’urbanisme d’Olbia reflète l’influence grecque : la cité était organisée selon un plan orthogonal, structuré par des îlots réguliers, des remparts massifs et des portes fortifiées.
Ce dispositif révèle à la fois une fonction militaire et une volonté de créer un espace urbain stable, destiné à accueillir colons et commerçants.
2. La romanisation et l’essor portuaire
À partir du IIᵉ siècle av. J.-C., et plus encore après la conquête romaine de la Gaule méridionale (vers 125-121 av. J.-C.), Olbia passe sous domination romaine.
La cité conserve une importance régionale en tant que port militaire et relais maritime, notamment dans le cadre des guerres contre les Ligures. Les Romains adaptent l’urbanisme hérité des Grecs, tout en intégrant de nouvelles infrastructures et en stimulant l’activité économique.
Le port d’Olbia joue alors un rôle clé dans le commerce méditerranéen : il permet l’importation de produits méditerranéens (huile d’olive, vin, céramiques) et l’exportation des productions locales (sel, poisson, vin de Provence).
Les vestiges archéologiques témoignent de cette activité : amphores massaliètes et italiennes, céramiques sigillées, objets liés à la pêche et à la transformation du poisson.
3. Olbia dans son environnement : un carrefour maritime et culturel
Olbia occupe une place particulière dans le paysage antique du littoral provençal.
Contrairement à d’autres établissements purement militaires, elle combine plusieurs fonctions : défensive, commerciale et agricole. Son territoire environnant, riche en ressources (plaines cultivables, lagunes salines, zones de pêche), a contribué à son autonomie et à sa prospérité.
D’un point de vue culturel, Olbia constitue un lieu de métissage gréco-romain : fondée par des Grecs, intégrée par les Romains, elle illustre la continuité et l’adaptation des modes de vie méditerranéens.
Les fouilles menées depuis le XIXᵉ siècle ont révélé non seulement des éléments d’architecture militaire et civile, mais aussi des traces de pratiques religieuses et cultuelles.
Le port gréco-romain d’Olbia, à Hyères, incarne un exemple remarquable d’implantation antique en Méditerranée occidentale.
À la fois colonie grecque, poste militaire et relais commercial romain, il témoigne de la dynamique des échanges maritimes et du processus de romanisation de la Gaule méridionale. Aujourd’hui, son site archéologique, ouvert au public et géré par le ministère de la Culture, constitue un patrimoine historique et culturel majeur, permettant de comprendre la complexité des interactions entre Grecs, Romains et populations locales dans l’Antiquité.
|