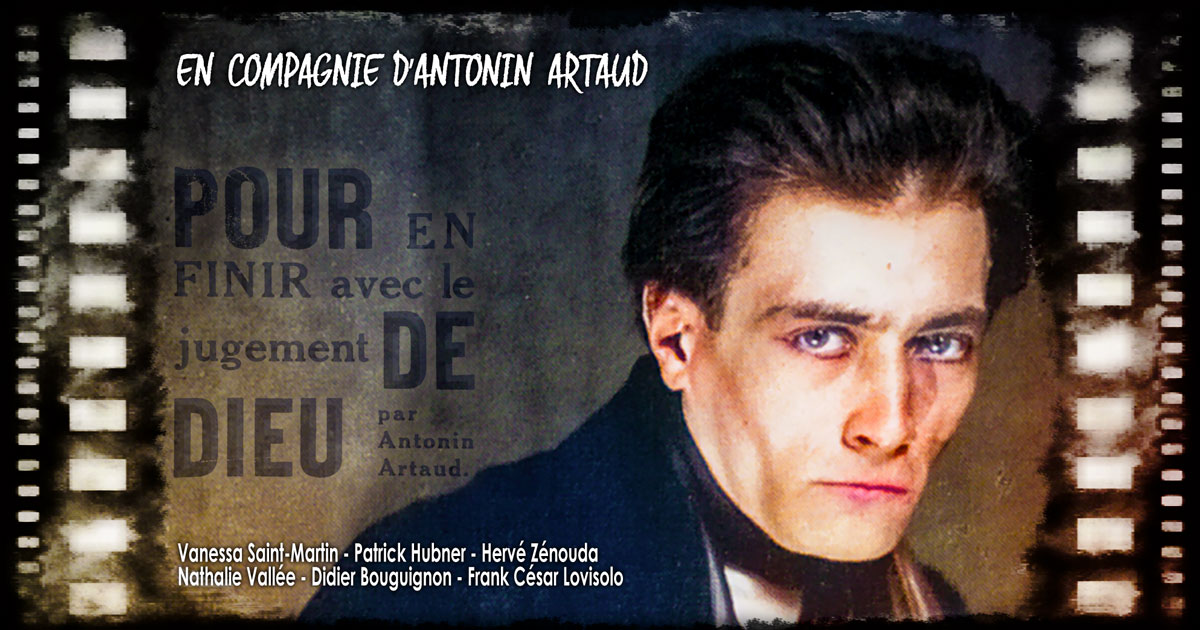|
 La mer Méditerranée est l’un des points chauds mondiaux de la pollution plastique : bassin semi-clos, forte densité de population côtière, tourisme saisonnier et pressions maritimes favorisent l’accumulation de macro- et microplastiques. Les plastiques flottants, sédimentés et ingérés par la faune affectent la biodiversité, les pêcheries et l’économie locale. Des avancées récentes permettent de mieux comprendre les « carrefours » de transport et la divergence entre quantités émises et quantités observées, mais des incertitudes persistent quant au stockage sédimentaire profond, au devenir des microplastiques et aux risques pour la santé humaine. ( Environment Programme, Nature) La mer Méditerranée est l’un des points chauds mondiaux de la pollution plastique : bassin semi-clos, forte densité de population côtière, tourisme saisonnier et pressions maritimes favorisent l’accumulation de macro- et microplastiques. Les plastiques flottants, sédimentés et ingérés par la faune affectent la biodiversité, les pêcheries et l’économie locale. Des avancées récentes permettent de mieux comprendre les « carrefours » de transport et la divergence entre quantités émises et quantités observées, mais des incertitudes persistent quant au stockage sédimentaire profond, au devenir des microplastiques et aux risques pour la santé humaine. ( Environment Programme, Nature)
Introduction
La Méditerranée est un bassin semi-fermé avec une circulation qui limite l’évacuation rapide des débris vers l’océan ouvert ; combiné à une forte pression anthropique, cela crée une accumulation persistante de plastiques. Les études récentes estiment des centaines de milliers de tonnes de matière plastique en circulation et mettent en évidence des zones côtières et sous-marines particulièrement impactées. (UNEP)
Sources et flux
Les principales sources sont terrestres (déchets urbains mal gérés, ruissellement, rejets fluviaux), activités maritimes (pêche, navires, aquaculture) et apports saisonniers liés au tourisme. Les modèles et observations montrent que la plupart des apports restent dans le bassin méditerranéen plutôt que d’en sortir, d’où l’image d’une « trappe à plastique ». (American Chemical Society Publications, UNEP)
Distribution et devenir des plastiques
Impacts écologiques et socio-économiques
- Faune : enchevêtrement, ingestion (tortues, oiseaux marins, poissons, mammifères) et effets sub-létaux (blocage digestif, réduction d’appétit, faux sentiment de satiété, transfert de polluants adsorbés). (Frontiers)
- Écosystèmes benthiques : plastiques sur le fond modifient l’habitat (enrobage des habitats benthiques, transport d’espèces invasives, altération des processus biogéochimiques). (SpringerOpen)
- Société et économie : coûts pour le tourisme, la pêche, la navigation ; risques pour la sécurité alimentaire via la contamination des ressources marines. Les estimations économiques régionales montrent des pertes importantes pour les secteurs côtiers. (UNEP)
Méthodes et progrès récents
Les approches combinent observations de terrain (manta trawls, prélèvements de sédiment, analyses en laboratoire), suivis citizen-science, imagerie satellitaire couplée à modèles numériques Lagrangiens pour tracer les particules, et modélisation de transport et de dépôt. Des campagnes et synthèses récentes (ex. Tara, études de synthèse) ont amélioré la résolution spatiale des hotspots et des trajectoires. (Nature, ScienceDirect)
Lacunes et incertitudes
- Quantification complète de la masse : difficulté à mesurer micro- et nanoplastiques et fraction enfouie dans les sédiments profonds. (American Chemical Society Publications)
- Effets sub-létaux et cocktails chimiques : interactions entre microplastiques et polluants adsorbés, vecteurs de pathogènes, effets chroniques sur la santé des organismes et potentiellement humaine. (Frontiers)
- Standardisation méthodologique : variabilité des protocoles (taille de maille, méthodes d’analyse chimique) empêche comparaisons directes entre études. (SpringerOpen)
Mesures d’atténuation et politiques
Conclusions et recommandations de recherche
- Approfondir l’inventaire massique (surface + colonne d’eau + sédiments profonds) et standardiser les protocoles d’échantillonnage. (American Chemical Society Publications, SpringerOpen)
- Développer études d’exposition/toxicité chroniques pour les espèces commerciales et évaluations du risque pour la santé humaine. (Frontiers)
- Cibler les « carrefours » identifiés pour mesures de prévention et récupération (efficacité-coût élevée) et renforcer la gouvernance régionale et la gestion des déchets urbains. (Nature,)
Références clés (sélection)
- Fiches et synthèses UNEP/MAP — Pollution in the Mediterranean.
- Borja et al., synthèses et rapports régionaux UNEP/Plan Bleu (State of the Environment and Development in the Mediterranean). (Lire)
-
van Sebille et al., « The streaming of plastic in the Mediterranean Sea » (Nature Communications, 2022) — identification des carrefours de transport. (Nature)
-
Cózar et al. / Lebreton et al. et études de bilan massique / « Closing the Mediterranean Marine Floating Plastic Mass Budget » (ACS EST, 2020). (American Chemical Society Publications)
- Revue Frontiers on microplastics in the Mediterranean (2021) — synthèse sur distribution et impacts biologiques. (Frontiers)
-
Études sur sédiments et fonds marins (SpringerOpen / MDPI synthèses récentes). (SpringerOpen, MDPI)
|

 La mer Méditerranée est l’un des points chauds mondiaux de la pollution plastique : bassin semi-clos, forte densité de population côtière, tourisme saisonnier et pressions maritimes favorisent l’accumulation de macro- et microplastiques. Les plastiques flottants, sédimentés et ingérés par la faune affectent la biodiversité, les pêcheries et l’économie locale. Des avancées récentes permettent de mieux comprendre les « carrefours » de transport et la divergence entre quantités émises et quantités observées, mais des incertitudes persistent quant au stockage sédimentaire profond, au devenir des microplastiques et aux risques pour la santé humaine. (
La mer Méditerranée est l’un des points chauds mondiaux de la pollution plastique : bassin semi-clos, forte densité de population côtière, tourisme saisonnier et pressions maritimes favorisent l’accumulation de macro- et microplastiques. Les plastiques flottants, sédimentés et ingérés par la faune affectent la biodiversité, les pêcheries et l’économie locale. Des avancées récentes permettent de mieux comprendre les « carrefours » de transport et la divergence entre quantités émises et quantités observées, mais des incertitudes persistent quant au stockage sédimentaire profond, au devenir des microplastiques et aux risques pour la santé humaine. ( La Méditerranée étouffe sous le plastique
La Méditerranée étouffe sous le plastique